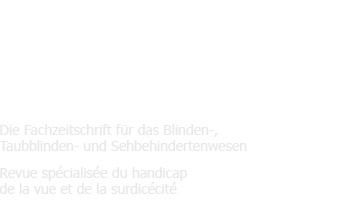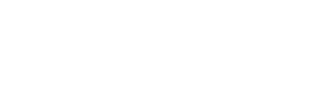Les personnes âgées ne veulent pas en plus être handicapées

Les personnes qui développent une déficience visuelle avec l’âge sont trop peu nombreuses à recourir aux offres de réadaptation proposées dans le domaine de la typhlophilie. Forte de dix ans d’expérience professionnelle au sein du centre de compétence pour les personnes âgées atteintes d’un handicap visuel et auditif (Kompetenzzentrum Seh- und Hörbehinderung im Alter [KSiA]), Judith Wildi présente ici les possibilités qui existent pour les aider malgré tout à surmonter un quotidien modifié par leur handicap visuel.
Par Judith Wildi
Les personnes âgées atteintes d’une déficience visuelle refusent d’être associées au terme de handicap. Leurs arguments les plus fréquents sont « Je ne suis pas malade, je ne suis pas handicapée, je ne vois pas bien, mais c’est normal à mon âge ». Les personnes concernées trouvent souvent les examens médicaux complémentaires superflus (« Ça ne vaut plus la peine. ») et estiment qu’elles n’ont pas leur place dans un service de consultation du domaine du handicap visuel (« Après tout, je ne suis pas handicapée »).
Le déni alimente les spirales négatives
Qu’est-ce qui retient les gens d’affronter dès le début l’évolution de leur situation et de demander de l’aide ? Leur réticence est probablement due, d’une part, au fait que tant la société que les professionnels méconnaissent les services existants et les possibilités qu’ils offrent. D’autre part, les aînés, et en particulier les personnes très âgées, ne veulent pas devenir une charge. Lorsque leur vue baisse, que leur quotidien devient difficile et que leur autonomie vacille, elles préfèrent donc se renfermer. Elles repoussent les changements. Dans le fond, leur attitude est tout à fait compréhensible, car l’autonomie est un bien précieux. Mais les personnes concernées ne se rendent pas compte qu’elles enclenchent ainsi une spirale négative : refuser le soutien proposé conduit bien souvent à un sentiment d’insécurité, au repli, à l’isolement social et, fréquemment, à des accidents susceptibles de nécessiter une hospitalisation voire l’entrée dans une institution de soins de longue durée. Les personnes concernées se sentent alors touchées dans leur autonomie. Certaines se résignent, d’autres se replient sur elles-mêmes, d’autres encore deviennent obstinées ou agressives.
Une identification difficile
Identifier un handicap ou un trouble visuel lié à l’âge n’est pas chose facile. La plupart des maladies oculaires qui apparaissent avec l’âge sont chroniques. Les changements étant par conséquent insidieux, il est difficile d’en évaluer l’ampleur. Ce sont les modifications soudaines, comme une perte massive et rapide de l’acuité visuelle, qui attirent l’attention.
De plus, il est important de connaître les particularités neuro-ophtalmologiques d’un handicap visuel. Si la plasticité du cerveau est fabuleuse, elle peut donner lieu à des situations perturbantes en cas de déficience visuelle. Lorsqu’un déficit apparaît lentement, par exemple dans le cas d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), la personne ne le perçoit pas comme une lacune dans son champ de vision. En effet, le cerveau remplace les informations manquantes par des contenus présumés, ce qui donne à la personne concernée une image complète, mais de qualité floue et terne : c’est le phénomène du remplissage ou filling-in. On ne voit (reconnaît) littéralement pas ce que l’on voit. La fille retrouve ainsi sur la table de chevet le bracelet que, ne le voyant pas, la personne concernée a cru perdu, accusant au passage la femme de ménage de l’avoir volé. De tels événements sont déstabilisants et accélèrent le retrait de la vie sociale. Un autre phénomène courant est le syndrome de Charles Bonnet (SCB) : en raison d’une acuité visuelle réduite, le cerveau peut créer des éléments d’image qui sont invisibles pour l’entourage. Il arrive alors que la personne concernée se sente ou soit considérée comme proche de la démence, ce qui est pesant. Pourtant, ce phénomène est comparable à une douleur fantôme visuelle et n’a rien d’un trouble psychiatrique. Malheureusement, de nombreux médecins ignorent ce syndrome. Lors d’un cours dispensé au personnel d’un EMS, à Zurich, il est ainsi apparu que la vieille dame qui voyait toujours des Chinois dans les arbres n’était pas « un peu cinglée », mais souffrait probablement d’un problème de vue. Quelle différence dans la perception que l’on a d’une personne !
Ce qui est terrible, c’est que de nombreux symptômes d’une déficience visuelle ressemblent à s’y méprendre à ceux d’une démence : le comportement social est altéré, la mémoire et la capacité décisionnelle s’amenuisent, l’orientation spatio- temporelle et les repères personnels se dégradent, l’aptitude à prendre soin de soi diminue, la dépression et la peur apparaissent ; d’où l’énorme importance de reconnaître un handicap visuel.
L’évaluation du focus pour faciliter l’identification
Se rendre compte qu’une personne âgée souffre d’une déficience visuelle est donc loin d’être aisé. Souvent les personnes concernées ne veulent pas se soumettre à des examens médicaux complémentaires « à l’avance ». C’est la raison pour laquelle le KSiA a mis au point un instrument destiné à aider le personnel infirmier à quantifier une éventuelle perte de la vue : l’évaluation du focus axée sur les déficits visuels.
L’évaluation du focus englobe la saisie de toutes les informations générales, le calcul du champ de vision horizontal et vertical au moyen du test des doigts (voir l’image), le calcul du besoin de grossissement de textes de lecture ainsi que l’évaluation de la sensibilité à l’éblouissement et de la perception des contrastes. Les conclusions d’un projet mené durant plusieurs mois par des membres du personnel des services d’aide et de soins à domicile ont démontré que la réalisation systématique d’évaluations du focus pouvait se révéler très utile (Seifert et al., 2020).
L’évaluation du focus ne remplace pas un examen médical. Elle donne simplement un aperçu de la situation et des risques susceptibles d’en découler, comme celui de trébucher. Discuter des résultats de l’évaluation avec la personne concernée peut par ailleurs contribuer à la convaincre de recourir aux offres de consultation du monde de la typhlophilie et aux moyens auxiliaires existants.
Le soutien des professionnels
Comme l’indiquait l’étude PROVIAGE (Seifert et al., 2023), les personnes concernées présentant une déficience visuelle liée à l’âge sont très peu nombreuses à utiliser les prestations des services de consultation. Cela s’explique, d’une part, par le fait qu’elles n’en ont pas connaissance et, d’autre part, par le manque de contacts entre le personnel médical et les services de consultation. Les contacts personnels aident à convaincre les personnes concernées de l’utilité des offres de consultation.
Ces possibilités de conseil sont complétées par un autre instrument important, à savoir les mesures de stabilisation et de réadaptation spécifiques au handicap visuel fournies par le personnel infirmier. Grâce à des moyens auxiliaires simples, comme des points de marquage, les mesures de stabilisation permettent de faciliter les actes de la vie quotidienne. L’amélioration de l’éclairage au moyen de sources lumineuses individuelles est également très efficace.
Parmi les exercices de réadaptation et l’accompagnement spécifiques au handicap visuel figurent l’entraînement cognitivo-émotionnel, qui vise à redonner courage aux personnes concernées résignées et repliées sur elles en leur expliquant que la situation peut évoluer, qu’il est possible d’apprendre même à un âge avancé et qu’il existe des offres et des moyens auxiliaires adaptés. Dans ce contexte, il vaut mieux éviter de parler de handicap et plutôt évoquer un déficit visuel ou un problème de vue.
Les exercices moteurs et fonctionnels ont quant à eux pour but de permettre aux personnes concernées de retrouver la capacité de faire certaines choses elles-mêmes. C’est à elles de décider ce qu’elles souhaitent apprendre et dans quel domaine elles ont besoin d’aide.
Les différentes spécialisations de la typhlophilie en matière de réadaptation – les activités de la vie journalière, l’orientation et la mobilité ainsi que la basse vision – proposent une multitude d’offres à cet égard.
Enfin, il est essentiel de toujours rappeler aux personnes concernées qu’avant d’acheter un moyen auxiliaire, elles devraient demander à un service de consultation de le leur présenter et de les former à son utilisation. Plus une personne se familiarise tôt avec un moyen auxiliaire, mieux c’est : il est plus facile d’apprendre quand on voit que lorsque le handicap est avancé. Il faut toutefois souvent de l’aide pour franchir ce pas.
Elle le fait
Voici un exemple puisé dans mon entourage privé : sensibilisée par la maladie de ses deux parents, l’une de mes amies a immédiatement réagi lorsque sa vision a changé. Sans tarder, elle a demandé des conseils et cherché le dialogue. Elle est prête à affronter ce qui l’attend et entend décider elle-même ce qu’elle envisagera à quel moment. Elle pourrait littéralement fermer les yeux et – aussi longtemps que cela lui sera possible – continuer à tout faire et savourer, en repoussant l’inéluctable à plus tard. Mais il n’en est rien : elle profite de la vie et coud, tout en adaptant d’ores et déjà son environnement à l’aide de moyens auxiliaires (par exemple de meilleures sources d’éclairage). Elle choisit ce qu’elle attend de qui. L’autodétermination ne signifie pas devoir tout faire tout seul, mais prendre ses décisions en toute connaissance de cause et déterminer ce que l’on préfère faire soi-même et les domaines dans lesquels on a besoin d’aide. Et nous en arrivons au but de cet article : mettre l’accent sur les possibilités offertes par une action précoce et sur les risques de se voiler la face. La vie peut être colorée et valoir la peine d’être vécue, même avec un handicap visuel lié à l’âge.
A propos de l’auteure
Judith Wildi, infirmière HES, pédagogue, MAS en gérontologie sociale, membre fondateur et de l’équipe de KSiA jusqu’en 2021, collaboratrice au développement de la profession et responsable de formations et de cours.
KSiA, le centre de compétence pour les personnes âgées atteintes d’un handicap visuel et auditif, a cessé son activité en 2021. Les résultats de ses travaux (dossiers de travail, matériel didactique, rapports de projets et bibliographie) peuvent être téléchargés gratuitement (en allemand uniquement) sur son site Internet à l’adresse www.ksia.ch.
Bibliographie :
www.ksia.ch
Heussler, F., Wildi, J. & Seibl, M. 2016. Menschen mit Sehbehinderung in Alterseinrichtungen – Gerontagogik und gerontagogische Pflege – Empfehlungen zur Inklusion. Zurich, Seismo.
Rapport Seifert et al. (2020). Sehbehinderung im Alter im Pflegekontext: Langzeituntersuchung der Wirkungen der KSiA-Schulungen im Rahmen der Projekte ALESI und Spitex-SiA zu Sehbehinderungen im Alter. Zentrum für Gerontologie, Universität Zürich & KSiA. https://ksia.ch/onair/ pdf/Kurzbericht_KSiA_ZfG_2020.pdf
Évaluation du focus : instructions et documents sont disponibles sur https://ksia.ch/onair/materialien/ fachpraxis/pflege_betreuung/