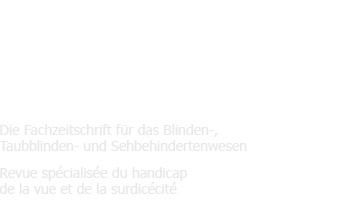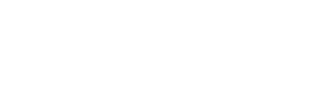Entendre, toucher, apprendre : à la conquête de la langue allemande avec un handicap visuel
Dans le cadre d’un projet pilote à Zurich, des personnes malvoyantes et aveugles de langue étrangère apprennent en groupe l’allemand de manière unique : sans support de cours ni tableau noir, mais en se servant beaucoup de l’ouïe et parfois du toucher. Les participants relèvent les défis inhérents à l’acquisition d’une langue et démontrent ainsi que les éventuelles barrières visuelles dans ce contexte peuvent être surmontées.

Par Michel Bossart
« J’habite à l’extérieur de le centre. » Ina Condrea, qui se tient devant un groupe installé à des tables, lit une phrase et aimerait savoir si elle est correcte. « Est-ce que ‹ centre › est masculin ou féminin ? », demande Andrei au reste du groupe. « C’est le centre », répond Nassir avec aplomb. « Et ? », insiste Ina Condrea, « La phrase ‹ J’habite à l’extérieur de le centre › est-elle correcte en allemand ? »
Nous sommes à la Sehhilfe Zürich : Dans la salle de classe du cours d’allemand pour personnes en situation de déficience visuelle, les étudiants doivent en principe venir à bout des mêmes difficultés que dans les autres cours d’allemand. Sauf que ce cours-ci se passe de supports didactiques pour prendre des notes et de tableau noir permettant à l’enseignante de visualiser ses explications. Ici, la langue s’enseigne essentiellement par l’ouïe.
Ina Condrea est professeure d’allemand pour étrangers, soit pour des personnes qui veulent ou doivent apprendre l’allemand comme deuxième langue après être arrivées en tant que migrants en Suisse. Cela fait seize ans qu’elle dirige sa propre école de langues ; depuis janvier 2024, elle enseigne pour la première fois dans une classe constituée exclusivement de personnes avec une déficience visuelle.
En fait, il y a beaucoup de concurrence entre les écoles de langues en Suisse. Et pourtant, les offres pouvant convenir aux personnes malvoyantes ou aveugles sont rares, voire inexistantes. En tant qu’examinatrice Telc licenciée, Ina Condrea sait de quoi elle parle quand elle dit que les personnes malvoyantes et aveugles sont désavantagées pour apprendre une langue étrangère. « Telc » signifie « The European Language Certificates » et se réfère donc aux « certificats de langues européens ». La société à responsabilité limitée et sans but lucratif Telc, dont le siège se trouve à Francfort, développe et distribue plus de 40 examens de langues dans actuellement neuf langues européennes. Le fil conducteur en est le Cadre européen commun de référence pour les langues, qui est né d’une initiative du Conseil de l’Europe en 2001. En d’autres termes : Telc représente un standard de qualité en matière d’apprentissage et de certification de langues étrangères. Ina Condrea remarque à ce propos : « La personne qui souhaite passer des examens officiels de langue selon Telc a beaucoup de possibilités pour s’y préparer. Toutefois, jusqu’à présent, personne n’a pu me dire si lors des examens, les moyens auxiliaires tels que smartphones ou laptops sont autorisés pour les personnes avec une déficience visuelle. » Il est aussi difficile de savoir si l’examen écrit pourrait, pour les étudiants malvoyants et aveugles, être remplacé par une épreuve orale. Dans tous les cas, elle estime que la situation actuelle est discriminatoire pour les personnes en situation de handicap visuel dans la mesure où il n’existe par exemple pas d’examen d’entraînement adapté aux personnes malvoyantes et aveugles.
Toucher et apprendre
Les examens de langue sont un des problèmes, mais l’autre, probablement beaucoup plus grave, est le manque d’offres de cours pour pouvoir étudier la langue. La Zürcher Sehhilfe, le groupe régional Zurich (RGZ) de l’Union suisse des aveugles (USA), Sichtbar Zürich, un service de consultation de l’USA et de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), représentés par le centre de consultation à Zurich ainsi que le Bildungs- und Begegnungszentrum (BBZ, centre de formation et de rencontre) Dietikon, ont donc lancé à Zurich un projet pilote afin de savoir si l’enseignement en groupe est efficace pour des personnes avec handicap visuel. Les participants viennent d’Afghanistan, d’Éthiopie, de Russie, de Côte d’Ivoire, d’Iran et d’Ukraine. « Surtout pour les nouveaux arrivants, qui n’ont pas encore de connaissances d’allemand du tout, le handicap visuel constitue un défi supplémentaire », se met à expliquer Ina Condrea. Alors qu’elle peut montrer aux étudiants voyants l’image d’un siège et leur dire que cela se dit « Stuhl » en allemand, elle doit procéder tout à fait différemment avec des personnes malvoyantes et aveugles. D’abord, la responsable a dû expliquer aux étudiants que l’apprentissage de la langue se ferait aussi par le biais du toucher. Par exemple pour expliquer le sens de « je » ou « tu ». Ou encore les principales prépositions telles que « sur », « derrière », « devant » ou « sous ». Ou justement « chaise ». Dans ce cas, Ina Condrea va vers chaque étudiant, lui prend une main pour l’amener jusqu’à la chaise, la lui fait toucher et lui dit : « Das ist der Stuhl; ein Stuhl. » (C’est la chaise, une chaise).
Avec ou sans moyens auxiliaires
La classe des avancés a déjà acquis ce vocabulaire de base. Aujourd’hui, ils vont aborder des notions plus abstraites liées aux thèmes de la route et de la circulation : conducteur, feux de signalisation, arrêter, traverser, rouler tout droit, tourner, passage pour piétons, accident, blessé, rond-point. Les étudiants ne comprennent pas bien ce qu’est un rond-point après les explications orales de l’enseignante.

Elle va vers eux, forme un cercle avec ses mains, puis une croix, invite les étudiants à toucher ses mains et explique le mot encore une fois. Maintenant, ils ont compris. Ina Condrea épèle le mot : Andrei le saisit tout de suite sur son laptop et écoute dans ses écouteurs ce qu’il écrit. Grâce à son acuité visuelle résiduelle, Irina peut noter le nouveau mot sur une feuille A4 avec un gros feutre noir. Les autres participants retiennent les nouveaux termes grâce à l’ouïe.
L’allemand en tant que langue étrangère est difficile en raison des quatre cas, les trois articles et les diverses déclinaisons. Les personnes voyantes peuvent se mettre les tableaux des déclinaisons dans la tête visuellement, mais les personnes malvoyantes et aveugles ne peuvent compter que sur leur ouïe et leur mémoire. Pour la classe des avancés, le génitif constitue donc souvent la principale difficulté d’apprentissage.
Mais revenons à l’entraînement du vocabulaire : pour mieux retenir les nouveaux mots, les participantes et participants sont invités à discuter, en groupes de deux, un des trois thèmes suivants : différences entre la circulation urbaine et la circulation rurale dans votre pays d’origine, comparaison des transports publics en Suisse et de ceux de votre pays d’origine et comparaison des personnes avec handicap visuel dans la circulation en Suisse et dans votre pays d’origine. Les groupes se retirent et commencent à discuter. Pendant ce temps, l’enseignante veille à ce que les échanges se déroulent bien en allemand et ne passent pas à l’anglais ou au russe. Puis les étudiants se retrouvent ensemble et, avant que le cours ne se termine au bout de deux heures, ils partagent entre eux leurs connaissances.
Commencer par des questions
Ce matin, l’ambiance dans la salle est bonne, les participants sont motivés et ont envie d’apprendre. On sent que pour eux, le cours est une distraction bienvenue qui les amuse dans leur quotidien. L’enseignante les encourage à écouter la radio en allemand, notamment parce qu’ils n’ont guère l’occasion de pratiquer cette langue pendant la semaine. Comme pour toutes les personnes qui apprennent l’allemand en Suisse, les participants au cours se heurtent au dialecte parlé dans la vie de tous les jours. À l’école, on apprend le Hochdeutsch, mais ce n’est pas ce qu’on entend dans la rue.
En classe, Ina Condrea leur apprend l’allemand de manière ludique. Pour ce faire, elle utilise son propre matériel pédagogique : « D’après mon expérience, les supports de cours usuels décrivent souvent des situations un peu artificielles. Moi je tiens à mettre d’emblée les apprenants en contact avec la langue quotidienne. Le point de départ est souvent une question : où habites-tu ? d’où viens-tu ? quel âge as-tu ?, etc. Elle investit au moins deux fois plus de temps pour préparer ces leçons. En effet, tout ce qu’elle peut transmettre visuellement à des étudiants voyants doit être adapté aux besoins des participants en situation de déficience visuelle. Elle doit créer des fichiers audio supplémentaires pour tout, qu’elle met à disposition après le cours.
Pour ce projet pilote, elle a été rémunérée comme pour un cours destiné aux participants voyants. Après la première phase d’essai, qui a duré de janvier à mars, et le second cours, qui a eu lieu entre juin et fin août, elle est confiante que le cours d’allemand pour étudiants malvoyants et aveugles aura sa place dans l’offre des organisations pour les aveugles dans la région zurichoise et que sa rémunération sera révisée à la hausse en fonction du temps investi plus important. Il serait souhaitable que l’exemple zurichois fasse des émules et que dans les autres régions germanophones de Suisse, des cours d’allemand pour personnes en situation de handicap visuel soient proposées. Le projet pilote a montré que l’enseignement en groupe est aussi efficace pour des personnes avec déficience visuelle.